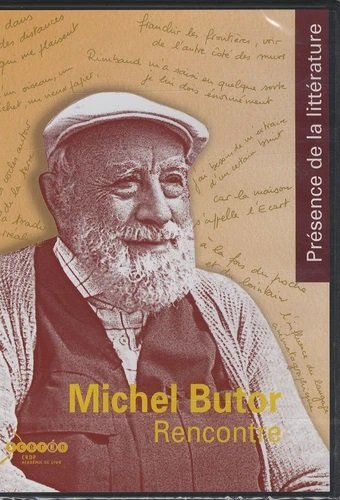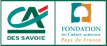Catégorie:
La parole à
Sofiane Laghouati, conservateur au musée de Mariemont
Accueil Magazine La parole à Sofiane Laghouati, conservateur au musée de Mariemont
mardi 15 décembre
La parole à
Portrait

Sofiane Laghouati est conservateur et chercheur qualifié au Musée Royal de Mariemont, conservateur scientifique coresponsable de la réserve précieuse (période 1830-aujourd’hui).
Depuis 2010, il a réalisé une dizaine d’expositions autour des collections sous sa responsabilité (livres, littérature et arts contemporains et graphiques). Il est également professeur invité à l’Université de Louvain-La-Neuve en Belgique où il enseigne, depuis 2010, la littérature ainsi que l’histoire du livre et de son graphisme.
Auteur de neuf ouvrages, dont des biographies de Michel Butor (2007) et d’Henry Bauchau (2010), auquel il consacre une e-publication numérique (2018), il a réalisé plus de 40 articles portant tout aussi bien sur la littérature, les archives, les livres d’artistes ou les arts graphiques.
Il codirige avec Myriam Watthee-Delmotte (Académie royale de Belgique) et David Martens (Katholieke Universiteit Leuven) la plateforme numérique Littératures Modes d’emploi et, avec ce dernier, le groupe de recherche international RIMELL (Recherches Interdisciplinaires sur la Muséographie et l’Exposition de la Littérature et du Livre).
Il est également membre de plusieurs sociétés savantes et littéraires en Belgique et en France, ainsi que de groupes de recherche internationaux comme le Centre de Recherche sur l’Imaginaire (UCL), l’unité mixte de recherche CNRS/Paris-Sorbonne Nouvelle (Paris3) THALIM (Théorie et Histoire des Arts et des Littératures de la Modernité XIXe-XXIe siècles) ainsi que de FIGURA, le centre de recherche sur le texte et l’imaginaire des Universités de Montréal (UQAM et UM) au Canada.
I. Comment avez-vous découvert l’écrivain Michel Butor et dans quel cadre l’avez-vous rencontré ?
Je me sens dans une sorte de dette infinie envers l’homme et son œuvre : j’ai l’impression de leur devoir en partie celui que je suis devenu intellectuellement et le métier que j’exerce aujourd’hui. J’ai découvert l’œuvre de Michel Butor à l’adolescence au milieu des années 1990 : je m’intéressais à l’époque à l’alchimie et j’ai eu la chance de lire son article « L’Alchimie et son langage » (1953) qui proposait une hypothèse de lecture très différente de celles développées par la plupart des chercheurs, plus ou moins sérieux, sur le sujet. Puis j’ai lu Portrait de l’artiste en jeune singe (1967) − un récit où quête initiatique alchimique, fiction et autobiographie s’intriquent−, et j’étais à la fois fasciné et dérouté par la liberté qu’il s’octroyait face à la chose littéraire : j’ai voulu comprendre, élucider le mystère alchimique de son œuvre puis j’ai été séduit par ce personnage avec sa grande barbe blanche tout en salopette, timide comme un enfant, d’une créativité et d’une érudition si étendue que je parviens, aujourd’hui encore, difficilement à en discerner tous les contours… C’est ainsi que je suis devenu vers 15/16 ans un lecteur de l’œuvre de Michel Butor : certes, j’ai été souvent désarçonné par ses romans, n’ayant pas alors les clés de lecture ni la maturité ou la culture nécessaires pour saisir les références et leur subtilité, mais j’ai eu, pour la première fois de ma vie, le sentiment qu’avec lui arrivait quelque chose d’inédit à la littérature.
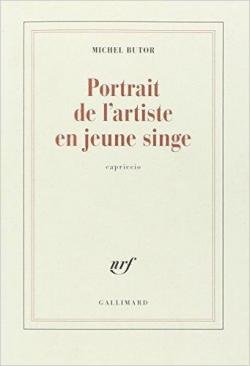
Par la suite en 2004, alors que j’entreprenais une thèse sur Assia Djebar et Claude Ollier − un autre écrivain associé au « nouveau roman »−, sous la direction de Mireille Calle-Gruber, j’ai été amené à découvrir ses essais et cette belle réflexion qui allait toujours de pair avec son activité de création. Le cours de la vie m’a conduit pour un an à Nice en 2005-2006, je vivais à quelques mètres de la Bibliothèque de recherche Romain Gary/Emile Ajar où Butor avait déposé ses archives : il avait vécu à Nice de 1970 à 1986 dans sa maison (Aux antipodes) et, profitant d’un déménagement, se délesta d’une partie de sa bibliothèque (plus de 10 000 livres je crois) et de ses avant-textes (manuscrits, tapuscrits, épreuves corrigées…). Or Mireille Calle-Gruber, qui dirigeait alors l’édition scientifique des œuvres complètes de Michel Butor, m’a demandé d’être son assistant d’édition et de lui fournir une sélection de documents du Fonds Butor pour illustrer la publication. J’ai donc commencé à explorer de plus en plus l’œuvre et les archives de Michel Butor. L’intérêt que nous portions au Fonds Butor a convaincu la conservatrice de la bibliothèque qu’il y aurait matière à une collaboration en vue d’une valorisation patrimoniale des documents : je me suis retrouvé, dans la cadre d’un projet supervisé par Mireille Calle-Gruber et le CNRS, à proposer une tentative de valorisation de ses archives par un travail de génétique textuelle à destination du grand public. C’est d’ailleurs à la suite de ce projet, une fois ma thèse soutenue, que j’ai été engagé pour un projet analogue au Fonds Bauchau à L’Université Catholique de Louvain puis au Musée royal de Mariemont en Belgique.
Ma première rencontre avec Michel Butor a été très formelle : elle a eu lieu à Paris au début de cette période de recherche dans les manuscrits pour les œuvres complètes aux Editions de la Différence ; il m’avait écrit une lettre d’autorisation pour accéder et exploiter le manuscrit de son premier roman Passage de Milan, déposé à la Bibliothèque Nationale Française (site Richelieu) : le document s’achevait par son prénom en signature suivi de la silhouette d’un oiseau en vol suivi d’un trait − comme s’il fallait garder la ligne d’horizon…
Une rencontre plus intéressante fut celle en 2011 lors du colloque d’Heidelberg qui lui était consacré : ma chambre était à côté de la sienne et nous nous retrouvions le matin lors du petit-déjeuner à partager la même table. J’ai le souvenir de beaux échanges avec lui – autour notamment de ma passion première pour l’Alchimie, également sur le livre d’artiste − il était venu au Musée royal de Mariemont pour en parler lors d’un colloque et d’une exposition, bien avant ma prise de fonction… Je garde surtout le souvenir de sa désarmante timidité…
II. Sur quels textes, documentaires, ou ouvrages en lien avec Michel Butor ou le livre d’artiste avez-vous collaboré ? Pouvez-vous nous en parler ?
Je n’ai pas eu, malheureusement, la chance de collaborer avec Michel Butor. D’ailleurs à quel titre l’aurais-je fait ? Je ne suis pas artiste… Toutefois, en tant que chercheur et conservateur dans un musée, je publie des ouvrages, des articles, des catalogues et réalise des expositions : la pensée de Butor ainsi que son œuvre sont omniprésentes dans mes diverses activités, y compris dans le cadre de mon enseignement à l’Université…
En revanche, j’ai eu l’occasion de réaliser en 2007 un livret pédagogique accompagnant un DVD d’entretien, Michel Butor, rencontre, édité à l’époque par le Centre National de Documentation Pédagogique (aujourd’hui Réseau Canopé) pour leur collection « Présence de la littérature » à destination de l’enseignement secondaire. J’ai également participé au travail au long cours sur les Œuvres complètes, avec Mireille Calle-Gruber et Sarah-Anaïs Crevier-Goulet, pour lesquelles je faisais principalement de la recherche iconographique : ce fut pour moi l’opportunité de voir l’œuvre de Michel Butor d’un point de vue plastique.
III. Quels sont pour vous les apports de l’écrivain dans le domaine de la littérature?
Pour moi les apports de Michel Butor à la littérature sont colossaux : non seulement sa réflexion et son activité de création transportent la littérature dans d’autres champs mais elles font migrer également dans la littérature, les procédés, les techniques et les contenus de la musique, du cinéma, des sciences ou des arts plastiques.
Je considère que le véritable apport de Michel Butor est d’être parvenu à faire en littérature ce que les musiciens ont fait à la musique dans les années 1960/1970 : du « remix » non seulement dans les rééditions de son œuvre propre – à l’exemple d’Illustrations publié avec et sans images – mais également en prenant des extraits d’autres œuvres qu’il intrique à sa propre écriture à l’image de Boomerang (1978). Dans cet ouvrage, troisième de la série des Génie du lieu, tout en découvrant l’hémisphère sud et l’Australie en particulier, le lecteur visite les régions géographiques, voire mentales, inexplorées ou mal connues par l’auteur. Au milieu de la première page, un texte, imprimé en noir, fait masse : sans majuscule ni ponctuation, on peut y lire la description d’une terrible chimère − mêlant le lion, l’éléphant, le loup et l’ours – et surtout le début du portrait du butor tel que nous le donne à lire Buffon dans son Histoire naturelle. C’est l’occasion pour l’auteur de faire honneur à son « animal-totem » ainsi qu’il le rappelle, dix ans après, dans Le Retour du boomerang (1988) – qui est un faux livre d’entretiens avec Beatrice Didier qui lui donne l’opportunité d’expliquer le « mode d’emploi » de Boomerang tout en se racontant.
La fréquentation régulière du Fonds Michel Butor à Nice (comptant environ 41 000 feuillets tapuscrits proche du format A4) ainsi que le projet de valorisation patrimoniale, autour des premiers chapitres de Passage de Milan (1954), m’ont permis de voir qu’apparait très tôt chez l’écrivain une recherche esthétique qui est aussi formelle et que l’on retrouve dans toutes ses formes d’expression (roman, essais, poésie, livre d’artiste…) – je développe d’ailleurs ce sujet dans un article [1] qui peut être consulté en ligne ici. J’avais remarqué en outre que Michel Butor utilisait déjà le saut de ligne dans Passage de Milan pour indiquer au lecteur le changement de focalisation narrative comme les mouvements d’une caméra qui voyagerait d’un étage à l’autre, mais j’ai vu en outre que les jeux typographiques, que l’on retrouve ensuite sur l’ensemble de son œuvre, lui servent, notamment dans la poésie lorsqu’elle est déclamée, de partitions pour marquer les différents registres de voix.
Butor s’est d’ailleurs toujours intéressé aux innovations qui accompagnent non seulement sa pratique d’écriture – il a quand même écrit un « Eloge de la Machine à écrire [2]» puis un « Eloge du traitement de texte [3]» − mais il montre également une grande curiosité pour l’histoire du médium livre et de sa transformation. N’écrit-il pas dans « Propos sur le livre illustré [4]» :
« Au siècle prochain nos actuels livres de poche ou best-sellers auront disparu du commerce. Ce qui sera conservé sera le livre d’artiste. Tout ce qui est « beau » livre restera. Les bibliothèques aujourd’hui ne devraient acheter que des beaux livres qui resteront des trésors comme les anciens manuscrits. Nous devons travailler sur ces nouveaux moyens, et pour cela tirer le plus possible d’enseignement des anciens pour que le transfert se fasse avec un minimum de pertes. J’attends avec impatience les premiers CD-Rom d’artistes. Je suis un homme de l’ancien livre ; je suis comme Moïse apercevant la terre promise de l’électronique artistique. Je ne sais si je réussirai à entrer dans les murs de la Jéricho magnétique, mais je puis au moins la saluer de loin ».
IV. Votre doctorat portait en partie sur le « nouveau roman ». Quelle était selon vous la place de Michel Butor au sein de ce mouvement?
En réalité mon doctorat portait sur deux œuvres: celles de Claude Ollier et d’Assia Djebar. Deux œuvres qui, de prime abord, n’offrent que peu de prise à la comparaison : d’un côté, l’œuvre d’Assia Djebar est celle d’une romancière algérienne que l’on a tôt fait de cataloguer comme écrivaine « postcoloniale » parce que « francophone » ; de l’autre, l’œuvre de Claude Ollier est celle d’un écrivain français dont le nom reste accolé à celui du « nouveau roman ».
Il est vrai qu’à l’instar de Michel Butor, Claude Ollier fut considéré comme un des écrivains du « nouveau roman ». Pour moi, c’est une appellation, exploitée du reste avec beaucoup de génie par Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit, pour autant elle ne traduit pas pleinement les pratiques et préoccupations des différents écrivains ainsi réunis.
L’histoire a retenu que cette dénomination est apparue sous la plume critique d’Emile Henriot au Monde Emile Henriot, le 22 mai 1957, pour fustiger des œuvres comme Tropismes de Sarraute et La Jalousie de Robbe-Grillet : elle a été récupérée ensuite pour devenir une sorte d’étendard, principalement porté par Jean Ricardou et Robbe-Grillet, regroupant des écrivains aux préoccupations aussi variées que leurs écrits. Claude Ollier dès son premier récit fut considéré comme un « nouveau romancier » avec d’autres écrivains (Butor, Simon, Ollier, Pinget, Ricardou, Robbe-Grillet, Sarraute) qui ont tenté d’interroger la tradition romanesque française et de faire en sorte que leur pratique coïncide avec leur sensibilité contemporaine du monde et non plus avec des codes et conventions littéraires datant du dix-neuvième siècle.
C’est d’ailleurs l’un des grands reproches fait aux « nouveaux romanciers » : leur manque de respect des conventions de ce qui était considéré comme le réel en littérature et du « réalisme ». Michel Butor, qui s’en défend, dira que pour lui « Le roman se situe dans le monde des réalités, avec ses ramifications innombrables ». [5] Ollier, quant à lui, problématise la question dans une perspective similaire :
« Je n’emploie jamais « réel » non plus, qui implique toutes sortes de références philosophiques, linguistiques, historiques contradictoires, de Platon à Jdanov et Lukács. Et puis il y a langage dès les premiers instants, toute perception est depuis toujours immergée dans le langage, et toute sensation, tout souvenir. Le mot « arbre » est dans l’arbre, il y est toujours déjà, comme disent les philosophes […] Quand j’utilise le langage pour écrire, il me semble en faire déjà un usage second, voire un usage au troisième degré, si je tiens compte de la parole. On dit « réel » comme si existait un monde vierge de tout langage. C’est là un monde inaccessible. » [6]
Pour ces écrivains « nouveaux », le roman « romanesque », genre qui a sa marque dans la littérature française, a peu à peu instauré un certain nombre de règles qu’ils souhaitent interroger et repenser. C’est également une réflexion que l’on retrouve chez Nathalie Sarraute [7] et surtout chez Robbe-Grillet écrivant « De quelques notions périmées » [8] en littérature —où il bannit le personnage, l’intrigue, la téléologie narrative.
S’il y a un point commun entre lesdits « nouveaux romanciers » c’est bien celui du refus de figer la littérature. Il me semble plus juste de dire qu’ils donnaient à voir, chacun par des moyens différents, ce refus d’une certaine idée normative et répétitive de la littérature française et l’influence commune des littératures étrangères— notamment de Faulkner, Joyce et Woolf.
Ce rapport à la norme, à une forme de « doxa », est donc fort complexe. On a vu comment au cœur même du « nouveau roman », un certain appareil théorique excessif a parfois masqué la création littéraire qu’il était censé mettre en valeur. Il faut dire aussi que « l’excès théorique » de certains « nouveaux romanciers », comme Ricardou et Robbe-Grillet, a été un commode repoussoir allégué par tous ceux qui refusaient de reconnaître la subversion réelle qu’apportaient ces formes d’écritures.
Plusieurs « nouveaux romanciers », comme Michel Butor, Claude Ollier et Claude Simon, ont pris des distances par rapport aux positions quelques peu rigoristes des théoriciens du « nouveau roman ». A mon sens, Butor « sort » non seulement du romanesque mais également du « nouveau roman » déjà en 1962 avec deux œuvres fondamentales : Mobile, Étude pour une représentation des États-Unis et le livre de dialogue Rencontre avec le peintre chilien Enrique Zañartu. Cela n’a jamais signifié pour lui quitter la littérature mais plutôt la réinventer, en jouant avec ses formes traditionnelles et ses conventions, pour que nous puissions l’apprécier dans ses modalités contemporaines et non en l’évaluant en fonction des pratiques passées. In fine, Michel Butor a été, tout au long de sa vie, fidèle à la pensée qu’il avait formulée en 1955 dans son essai Le roman comme recherche :
« Le romancier qui se refuse à ce travail, ne bouleversant pas d’habitudes, n’exigeant de son lecteur aucun effort particulier, ne l’obligeant point à ce retour sur soi-même, à cette mise en question de positions depuis longtemps acquises, a certes, un succès plus facile, mais il se fait le complice de ce profond malaise, de cette nuit dans laquelle nous nous débattons. Il rend plus raides encore les réflexes de la conscience, plus difficile son éveil, il contribue à son étouffement, si bien que, même s’il a des intentions généreuses, son œuvre en fin de compte est un poison. » [9]
V. Vous êtes actuellement conservateur au Musée royal de Mariemont en Belgique. Pouvez-vous nous parler du fonds de livres d’artistes contenu par le musée ?
La Réserve précieuse est à l’image du Musée royal de Mariemont qui constelle en son sein différentes temporalités et réunit les œuvres de nombreuses civilisations. Réaménagée au gré des différentes donations, elle accueille les ouvrages bibliophiliques topiques des collections de la grande bourgeoisie du dix-neuvième siècle, à laquelle appartenait Raoul Warocqué (1870-1917) le donateur à l’origine du musée, mais aussi des références de la littérature automobile ou de l’entre-deux-guerres, une exceptionnelle collection de documents autographes comme les œuvres d’artistes contemporains dans de nombreux domaines du livre et de la littérature dont une collection de livres d’artiste(s) qui a été effectivement un des grands apports de la seconde partie du vingtième siècle.
Cette collection particulière s’est développée après la réouverture du Musée en 1972, douze ans après l’incendie qui a détruit le bâtiment principal : une nouvelle impulsion a été donnée par Marie-Blanche Delattre et Pierre-Jean Foulon, respectivement bibliothécaire et conservateur de la Réserve précieuse, qui avaient à cœur d’étendre l’expertise du musée dans de nouveaux domaines du livre. Grâce également au travail de veille et de diffusion de l’artiste – curateur – libraire – éditeur anversois Guy Schraenen, « les livres d’artiste(s) », en rejetons irrévérencieux de l’art contemporain, sont venus interroger à nouveaux frais les collections bibliophiliques traditionnelles.

Ces « livres d’artiste(s) » diffèrent, pour la plupart d’entre eux, de la vision, beaucoup plus large, que Michel Butor avait de ce médium : ils correspondent à une pratique qui a émergé, dans les années 1960, chez des artistes plasticiens, provenant pour une large part du mouvement Fluxus, de l’Art conceptuel ou du Minimalisme. D’ailleurs, comme je le disais plus haut, Michel Butor était venu à Mariemont pour parler de sa pratique et de sa vision du livre d’artiste : elles correspondent davantage à ce que nous pourrions qualifier d’un « dialogue par le livre », selon l’expression d’Yves Peyré, au sens où Butor nourrissait sa pratique scripturaire, généralement poétique, de la fréquentation esthétique et de l’influence des procédés mis en œuvre par les artistes avec lesquels il collaborait.
VI. Quels sont vos actuels sujets de recherche, souhaitez-vous nous présenter les RIMELL ou le site « littérature mode d’emploi » dont vous vous occupez ?
Mes recherches sont aussi diversifiées que les collections sous ma responsabilité ou mes centres d’intérêt : je me rends compte que je suis très chanceux ! Faire de la recherche comme du reste travailler sur des collections sont les pendants nécessaires au travail plus événementiel qu’est une exposition. Je viens d’ailleurs d’achever une exposition dont vous trouverez la version numérique ici et la publication qui lui est attenante : c’est le fruit de 2 à 3 années de recherches qu’il faut mener en parallèle à d’autres projets qui ont des échéances plus ou moins longues.
Nous avons reçu récemment plusieurs donations dont j’assure l’inventaire et l’étude : c’est le cas du fonds d’archives de « documentation Céline Duval » lié aux livres d’artiste(s) qui est arrivé en 2019. Mais il y a également des fonds plus anciens qui nécessitent d’être interrogés à nouveaux frais : nous disposons ainsi d’un Enfer (appellation sous laquelle se cachent des livres contrevenant aux bonnes mœurs) ayant appartenu au fondateur du musée, Raoul Warocqué (1870-1917), qui était grand amateur de littérature et d’images licencieuses- − j’explore à cette occasion la circulation des livres et des images malgré les interdits et c’est absolument passionnant.
Parmi les autres projets stimulants, je prépare également avec une collègue de la Sorbonne Nouvelle, Aline Bergé, un colloque international à Cerisy-la-Salle en août 2021 autour de l’écrivaine Leïla Sebbar, autrice engagée dans les combats féministes et sur les problématiques des parcours de vie pris dans les migrations – je présenterai à cette occasion une exposition autour de son œuvre et de ses archives.
Ce qui m’intéresse également depuis de nombreuses années, c’est la manière dont les récits évoluent à la faveur des transformations médiatiques : de l’oralité à l’écriture, du volumen au codex, de l’imprimerie à l’informatique et internet… Je suis toujours fasciné par la manière dont les récits vont migrer d’un support à l’autre avec une phase où le nouveau médium va imiter l’ancien puis inventer de nouveaux modes de narration et de nouveaux contenus, rendus non seulement possibles par la technologie mais également par les bouleversements socio-culturels qui l’accompagnent. Evidemment, avec sa présence durant plus d’un demi-millénaire, le livre joue un rôle central dans cette histoire.
C’est d’ailleurs l’une des motivations à la création, avec David Martens (professeur à la KU Leuven), des RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre) qui se veulent un réseau de « recherches appliquées ». Historiquement, le projet de ce réseau est né d’une exposition en 2012, « Écrivains : modes d’emploi. De Voltaire à bleuOrange (revue hypermédiatique) », réalisée au Musée royal de Mariemont en compagnie de Myriam Watthee-Delmotte (UC Louvain). Très rapidement s’est posée une série de questions : comment exposer la littérature et le fait littérature sans que l’exposition soit réduite à une série de livres en vitrine ? Comment ne pas réduire une œuvre au propos qu’on veut lui faire tenir ? Les autres manifestations et créations des écrivain.e.s sont-elles à caractériser de la même manière, s’intègrent-elles dans le fait littéraire ? Comment en rendre compte ? Etc.
Nous disposions alors de peu de documentation, mêlant réflexions et pratiques, aussi avons-nous décidé de créer ce réseau international qui se présente comme un espace de rencontres entre nos différents mondes et pratiques du livre et de la littérature : le monde muséal, celui de l’université et les divers acteurs qui interviennent dans de tels projets (artistes, graphistes, scénographes etc.).
Après quelques itérations, le site litteraturesmodesdemploi.org a été pensé comme une plateforme globale nous permettant d’explorer toutes ses questions et de voir comment d’autres essayent d’y répondre. Ce site contient l’ensemble de nos activités : des expositions conçues par nous ou que nous hébergeons ; les recherches entreprises lors de divers ateliers (RIMELL) ; une veille scientifique et muséale avec des comptes rendus d’exposition réalisés par des spécialistes du sujet (Exporateur littéraire) ;une Bibliothèque de documents et de catalogues d’exposition, Agenda culturel, et les Actualités scientifiques.
Notes :
[1] Sofiane Laghouati, « Michel Butor : (art)work in progress – du roman au livre d’artiste », dans Les graphies du regard : Michel Butor et les arts, actes du colloque à l’Université de Heidelberg du 21 au 23 septembre 2011 Heidelberg, Universitätsverlag, Winter 2013, pp. 63-71.
[2] Michel Butor, « Éloge de la machine à écrire », Répertoire IV (1979), dans Œuvres complètes, III, Répertoire 2, p. 437.
[3] Michel Butor, « Éloge du traitement de texte », dans Œuvres complètes, X, Recherche, 2009, p.103-104.
[4] Michel Butor, « Propos sur le livre illustré », dans Œuvres complètes, X, Recherche, 2009, p.489.
[5] Michel Butor, Entretiens, Quarante ans de vie littéraire, volume I, Paris, Joseph K., 1999, p. 35.
[6] Claude Ollier, Cité de mémoire, op.cit., p 51.
[7] Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956
[8] Alain Robbe-Grillet, « Sur quelques notions périmées », dans Pour un nouveau roman, Paris, Minuit (1961), 1996, pp 25-44.
[9] Michel Butor, « Le roman comme recherche », dans Répertoire I, Répertoire 1, dans Œuvres complètes, Paris, La Différence, (1955) 2006, p. 23.
[10] Michel Butor, « L’art et le livre », dans L’Art et le livre, Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, 1988, p.17-39.
[11] Voir à ce sujet : Yves Peyré, Peinture et poésie – le dialogue par le livre (1874-2000), Paris, Gallimard, 2001.
Image du bandeau :
Réserve Précieuse du Musée royal de Mariemont (c) M. Lechien